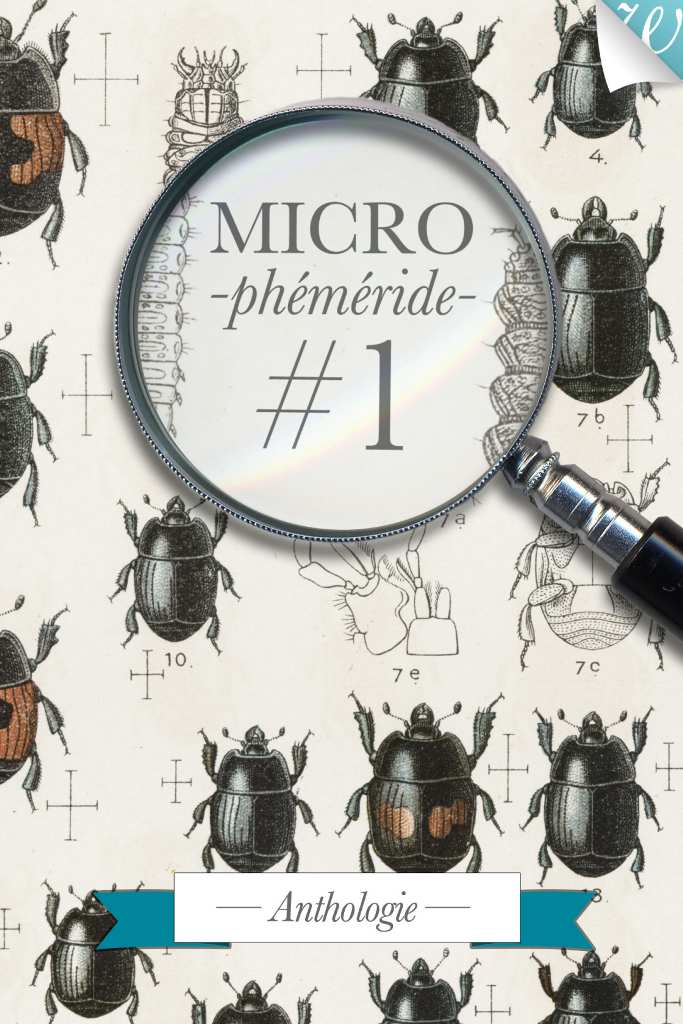À la recherche du bon mot : tous les coups sont permis
On en vient parfois à aller chercher les mots ailleurs que dans notre langue lorsqu’on écrit de la micronouvelle. Le recours à d’autres langues survient souvent dans l’utilisation de paronymie ou homonymie. Ce jeu sur la paronymie entre le français et d’autres langues (ici le latin) constitue d’ailleurs toute une section du Bulletin insondable de Vincent Corlaix et Olivier Gechter.
Dans cette microphéméride uchronique d’Olivier Gechter (oui, encore lui !) l’utilisation de l’anglais est l’occasion d’un quiproquo dû à la polysémie du mot employé :
Le 22 décembre 1944, en pleine bataille des Ardennes, le sergent Johnson, cuisinier de l’armée américaine encerclée à Bastogne reçoit un message de son homologue de la Wehrmacht : « Nous n’avons plus que de la crème de Spéculoos pour les desserts du mess. Qu’y ajouter pour avoir un peu plus de croquant ? »
L’américain, fair-play, résuma sa recommandation en un mot : « Nuts! »
Eh oui, les noix, fruits secs faciles à trouver en décembre, s’accordent très bien avec le parfum de cannelle de ces petits biscuits.
La réponse arriva accidentellement sur le bureau du général Hasso von Manteuffel qui venait d’envoyer une demande de reddition aux troupes américaines. L’officier allemand crut que le général américain l’envoyait paître et lança aussitôt une expédition punitive à la grande surprise du général Anthony McAuliffe qui s’apprêtait à rendre les armes. Vexé, ce dernier remotiva ses troupes et parvint à tenir le temps de recevoir l’aide de Patton.
La cuisine avait une fois de plus changé la face de la Seconde Guerre mondiale.
16 décembre 1944 – 25 janvier 1945 : bataille des Ardennes
À l’heure d’écrire la micronouvelle qui choque, interpelle, dérange ou surprend, l(a plupart d)es inhibitions tombent et l’auteur élargit son champ des possibles en allant piocher dans des champs lexicaux, des domaines de connaissance et des niveaux de langue qui ne lui sont pas forcément « familiers »… Familier donc et plus que ça, carrément vulgaire souvent, le niveau de langue de certaines de mes micronouvelles et de celles de mes congénères, du moins ceux de la Fabrique (même si certains énergumènes de la Microphéméride, comme Père Désœuvré et Nelly Chadour, ne sont pas en reste) ! L’argot est une façon de forcer les portes de la perception de la micronouvelle et d’ouvrir une réflexion sur le langage, la façon dont on peut tâter cet appendice quelquefois jugé nauséabond de la langue de Molière. Car après tout, l’argot a son étymologie, ses particularités et géniales trouvailles de langage qu’il serait dommage d’ignorer. Il permet parfois de décoincer certaines micronouvelles en cours d’écriture que l’on ne parvient pas à terminer.
L’expression « lâcher en renard » par exemple, m’a amené à réfléchir sur l’emploi du renard pour décrire l’acte de vomir. Cela m’a poussé à m’arrêter sur le mot « dégobiller », synonyme de ladite expression, puis sur le mot « dégoupiller » et a fini par m’inspirer cette micronouvelle :
Cet ivrogne qui chasse à la grenade ne s’étonne bien sûr pas que dégoupiller et dégobiller aient la même étymologie.
Alors bon, si vous faites quelques recherches, vous verrez bien que c’est du pipeau, les deux mots n’ont pas la même étymologie, mais je trouvais le rapprochement intéressant.
Il y a aussi parfois une dimension de « désacralisation » de la langue, dans le fait d’avoir recours à l’argot. On peut déboulonner certaines expressions figées, certains dictons paraissant immuables à coup de gros mots :
Francky Vincent dans le traîneau, partouze de lutins dans les cadeaux. (Karim Berrouka)
On peut aussi jouer sur un brusque changement de niveau de langage dans un texte en apparence « classique », pour un effet maximum, comme je le fais ici :
Mes voisins sont des vampires. J’ai bien observé : ils ne sortent jamais leurs poubelles. C’est donc qu’ils ne mangent pas. Ou sont juste de gros dégueulasses.
À noter, puisqu’il faut aussi parler un peu du fond, tant qu’à faire, que les microauteurs ont tendance à tremper leurs plumes dans le sang de muses de la SFFF, du polar, de la littérature érotique et du polar. Bref, les mauvais genres. On a pu avoir un début d’explication plus haut : l’utilisation de personnages déjà existants dans la mythologie, les contes ou la littérature est très tentante et permet d’obtenir une concision souhaitée vu que l’on ne s’embarrasse pas de caractériser ces personnages déjà connus du lecteur. On avancera aussi que la volonté de surprendre, de choquer et/ou de trouver le bon mot conduit logiquement le lecteur sur ces terrains de jeux. Mais un auteur de littérature « blanche », Éric Chevillard avec son Autofictif, constitue plutôt un contre-exemple, même s’il lui arrive de faire des incursions dans ces genres. Ses brèves sont plutôt ancrées dans le réel… avec le plus souvent un léger décalage et un ton qui les rapprochent de l’absurde. Lequel absurde n’est pas finalement très éloigné du fantastique (thématique autour de la folie, structure du récit parfois éclatée ou troublante…). Là aussi, l’un des effets recherchés par L’Autofictif est bien souvent la surprise.
Un de ces genres en particulier, ainsi que l’a fait remarquer Santiago Eximeno dans Técnica del microrrelato, un document préparatoire à la tenue d’ateliers de microécriture, semble particulièrement adapté à l’écriture de short short stories et contribue à dire que les flash fictions ne sont pas « simplement » des blagues. Il s’agit de la terreur :
[…] la terreur, comme l’a démontré, entre autres, Michael Arnzen dans son œuvre tant sur le réseau que sur papier, est le genre idéal pour la micronouvelle. Dans la short short story, l’auteur de littérature de terreur fait abstraction du superflu (du décor, des personnages, de la trame même), pour nous montrer un instantanée, une photographie d’un moment d’horreur pur, direct, qui peut provoquer un frisson chez le lecteur. En moins d’une centaine de mots, il est possible de transmettre au lecteur toute une gamme de sensations désagréables, douloureuses, attrayantes[7].
On ne résistera pas au plaisir de vous livrer quelques exemples parlants d’Eximeno, qui prêche, n’en doutez pas, pour sa propre paroisse, héhé :
Ça n’était pas une poupée. Il n’était pas démontable. C’était ton petit frère, pour l’amour de Dieu. Et non, ce que tu as fait ne peut pas se réparer.
Aujourd’hui dans un parc, un garçon m’a souri. J’ai gardé son sourire, il m’accompagnera toujours. J’espère que sa mère enterrera le corps[8].
Pour la science-fiction, les micronouvelles ont même leurs prix[9], c’est dire !
Il y a par contre, à ma connaissance, assez peu d’incursions des micronouvellistes dans des univers de fantasy pure – et non plus des emprunts aux contes de fées –, sans doute parce que la fantasy demande à poser un univers (géographie, peuples, religions, castes, Histoire…) ce que ne permet pas la micronouvelle en tant que telle.
Après, écrire des microfictions sur des œuvres de fantasy déjà existante et bien connues du public, des sortes de microfanfictions, quoi, est toujours possible. Santiago Eximeno avait par exemple écrit une dizaine de micronouvelles mash up de la Bible/Le Seigneur des anneaux.
Donc voilà, pour ouvrir le sujet et inviter les microauteurs en herbe à écrire, pensons à la fantasy de demain, qui sera à coup sûr composée de trios de micronouvelles et non plus d’interminables décalogies de parpaings !
[7] « […] el terror, como ha demostrado –entre otros– Michael Arnzen en su obra tanto en la red como en papel, es el género idóneo para el microrrelato. En el microrrelato, el autor de literatura de terror prescinde de lo superfluo (del decorado, de los personajes, incluso de la trama misma) para mostrarnos una instantánea, una fotografía de un momento de horror puro, directo, que pueda provocar en el lector un escalofrío. En menos de un centenar de palabras es posible transmitir al lector toda una gama de sensaciones incómodas, dolorosas, atrayentes. Extrait de Técnica del microrrelato, Santiago Eximeno (document de travail, non publié)
[8] Lambeaux de ténèbres, Santiago Eximeno (éditions Outworld/Kymera)
[9] Le fameux Pépin, déjà mentionné.
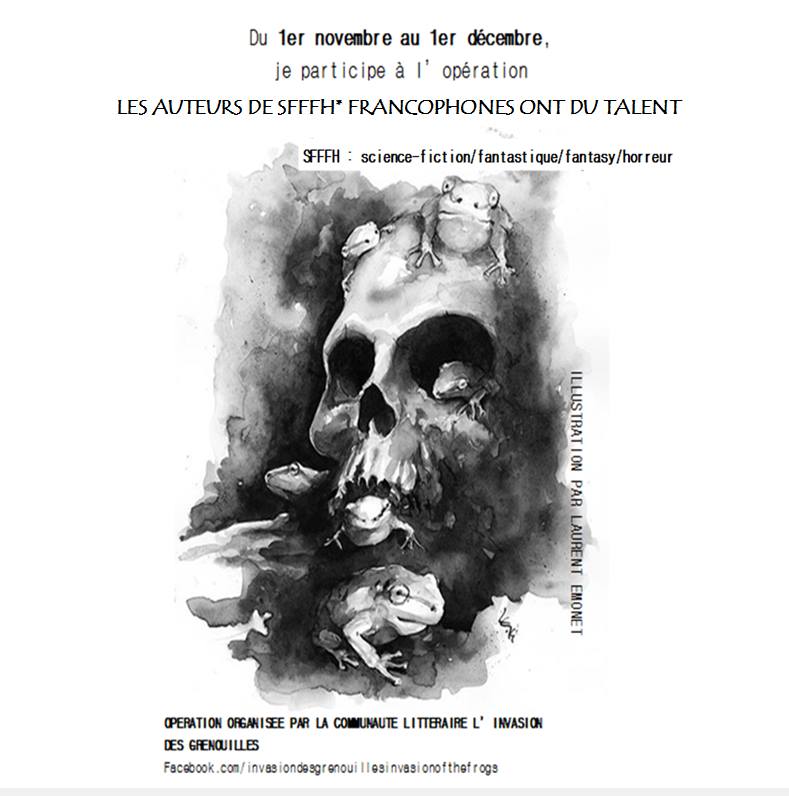 Le projet suivant de L’Invasion des Grenouilles se déroulera fin janvier. Il sera très différent puisqu’il visera cette fois à promouvoir la SFFFH francophone auprès des éditeurs anglophones par le biais de l’envoi à ces derniers d’un manifeste, de textes traduits et d’une lettre de soutien signée par des lecteurs, auteurs et éditeurs de SFFFH français, belges, québécois, etc.
Le projet suivant de L’Invasion des Grenouilles se déroulera fin janvier. Il sera très différent puisqu’il visera cette fois à promouvoir la SFFFH francophone auprès des éditeurs anglophones par le biais de l’envoi à ces derniers d’un manifeste, de textes traduits et d’une lettre de soutien signée par des lecteurs, auteurs et éditeurs de SFFFH français, belges, québécois, etc.