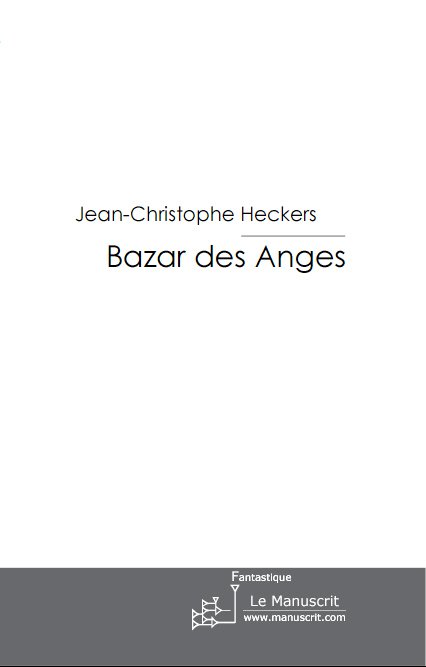 Nous sommes à la toute fin 2005. Jadis et autrefois. En des temps immémoriaux. Nous les nommerons, par commodité, l’Ère du Grand Ratage. Mais voyons comment les choses se sont déroulées.
Nous sommes à la toute fin 2005. Jadis et autrefois. En des temps immémoriaux. Nous les nommerons, par commodité, l’Ère du Grand Ratage. Mais voyons comment les choses se sont déroulées.
Après avoir longtemps hésité, j’ai fini par jeter mon dévolu sur un éditeur dont l’esprit d’innovation a réussi à me séduire. La charte éditoriale me semble tout à fait correcte et je suis prêt à faire quelques efforts pour que le livre puisse connaître une certaine diffusion. J’envoie donc mon manuscrit par la voie électronique requise et attends patiemment.
Vient 2006 et, début janvier, je reçois une réponse positive. La célérité dont on a fait preuve ne me suscite aucune suspicion particulière, c’est pourquoi je signe le contrat le 23 du même mois. Sans me préoccuper d’une certaine clause qui m’embêtera plus tard. L’enthousiasme aveugle, ai-je fini par conclure.
Le bon à tirer est reçu le 14 août, après avoir beaucoup et lourdement insisté. Entre un minimum annoncé de dix semaines et les trente au bout desquelles je l’ai vu tomber, il y a une certaine marge. Les promesses de le voir me sauter à la figure incessamment étaient restées vaines, semaine après semaine, jusqu’à ce qu’on incrimine le nombre d’ouvrages en attente. Soit.
Les premières corrections sont envoyées le 18 août. La mort dans l’âme : je ne puis en imposer que vingt, ce qui est nettement insuffisant après recensement de toutes les horribles coquilles oubliées. Les choix ont été drastiques, j’ai seulement pu remédier au pire. Le 21, je rends ma copie définitive. Consterné et résigné.
Ce même jour le livre est « publié ». Et je m’en réjouis avec une modération excessive, conscient qu’il y avait encore beaucoup de nettoyage à faire. Mais c’est comme ça, je ferai avec.
J’opère alors une approche infructueuse de libraires pour une possible mise en rayon : non référencé sur Dilicom, le livre ne les intéresse pas. Sauf, quand il existera si j’ose dire réellement, pour le prendre en dépôt… Il est par ailleurs trop tard pour les « animations en bibliothèque » (on me suggère de voir pour la rentrée… 2007).
De septembre à octobre, appels téléphoniques et courriels via le formulaire de contact de l’éditeur pour savoir quand sera référencé le livre. J’obtiens juste l’assurance téléphonique que ce sera fait dans les plus brefs délais. Pour mémoire, l’éditeur s’engage dans sa charte à effectuer le référencement dès parution (sans mentionner le délai avant intégration sur l’indispensable Dilicom). L’auteur naïf ou trop confiant ne comprendra pas que ça traîne un peu, alors que ce serait si simple de lui expliquer pourquoi. Notons également, histoire de rire un peu plus, qu’il est certifié que tout ouvrage publié bénéficie de l’inévitable dépôt à la BNF. Or c’est, permettez l’expression courtoise, un pipeau pour mutants à seize doigts (ou alors, dites-moi pourquoi l’obligatoire mention dudit dépôt ne figurait-elle pas sur l’ouvrage imprimé que je me procurai ?).
Le 30 octobre, face au silence obstiné de la partie qui me semble désormais adverse, j’adresse un courrier avec AR pour réclamer mon référencement. Pas de réponse, mais… le livre apparaît sur les bases idoines et partout où il faut aux alentours du 10 novembre.
Quelle stupéfiante coïncidence, le 14 novembre (joyeux anniversaire, mon connard), j’obtiens enfin une réponse du service commercial aux courriels, pour remarquer que le livre est référencé ici, ici, et là aussi, et que même il en a été commandé quatre exemplaires en librairie. (Qui failliront ne jamais être reçus avant l’année suivante, malgré les relances faites auprès du fournisseur de parallélépipèdes en papier.)
Je tente alors de relancer des libraires, qui, pour rester poli, se désintéressent souverainement de la question, se souvenant que je les avais approchés alors que le livre n’était pas disponible, sauf auprès de l’éditeur (qui leur semblait peu enclin à fournir l’ouvrage, ou dont ils se méfiaient à outrance). J’essaie ailleurs et essuie des refus ou des propositions de mise en dépôt (qui ne me tirent que des grimaces).
Et forcément, ventes néant, même en étant présent sur le site Littérature.tv, sur le Portail du Livre, en faisant ma « pub » sur divers forums…
J’en étais las.
Se retrouver avec un livre qui se révèle mort-né, ça fait assez mal. Même si le roman était, en fin de compte, plutôt moyen. Avant d’être disponible, il était déjà dans les profondeurs du catalogue et s’y enfonçait chaque jour davantage, écrasé par plusieurs ouvrages tout juste éclos. Il n’y avait eu aucun effort, même minimal, de promotion de la part de l’éditeur, qui s’était contenté d’un simple référencement sur des moteurs de recherche ou des sites marchands. Ce fichu texte, je voulais qu’il fût édité moins pour le vendre, mais pour qu’il soit lu, en vrai livre. L’effet était inverse : je m’étais dépouillé de mes droits pour le jeter dans les limbes.
Il aurait fallu, sans aucun doute, que je me décarcasse plus : salons du livre et foire aux bestiaux (parfois c’est la même chose) sont des lieux où il faut être présent pour se faire connaître ou rencontrer le dédain d’un public avide de pages fraîches. (Enfin, moins maintenant, certes.) Or, il eût fallu que j’investisse en frais de transports, en frais d’inscription pour avoir mon petit coin de table, et que je constitue mon propre stock de petits volumes. Sans avoir l’assurance de rentrer dans mes fonds.
Ce genre de démarche, certes honorable, m’eût permis quelques maigres bénéfices hors des divins « droits d’auteur ». Car il ne m’échappait plus que le contrat comportait une clause démotivante : les sommes dues par l’éditeur étaient conservées par icelui, ce jusqu’à 150 €. Le défi ne pouvait que difficilement être relevé. D’autant qu’au prix de l’ouvrage s’ajoutaient alors 10 € de frais de port (sauf pour les commandes en librairie) qui représentaient presque 70 % du prix initial. Qui d’assez sensé aurait daigné s’offrir ma prose dans ces conditions ? Bien sûr, la possibilité demeurait de solliciter son libraire ; mais dès lors que la livraison mettait un temps fou pour (ne pas) arriver, le lecteur potentiel risquait de jeter l’éponge. La clause abusive mais pas tout à fait illégale (ou à peine légale) me faisait donc désormais grincer des dents. D’autre part, j’étais lié par un droit de préférence qui n’était que la simple promesse que les deux prochains ouvrages seraient flingués sur-le-champ dès que j’aurais apposé ma griffe sur leurs contrats.
Chat échaudé craint l’eau froide. C’est encore pis si on a le sentiment qu’il s’agit plutôt d’hélium liquide…
Dans cette malheureuse situation, j’avais rencontré sur le net bien d’autres auteurs. La résistance finit par s’organiser, fort publiquement, et quelques demandes de résiliation tombèrent presque en même temps sur le bureau du service contrats. La mienne partit le 23 janvier 2007. Le choix de certaine date anniversaire n’était qu’à peine prémédité. Courant avril, je serais enfin libre et soulagé. Mais, encore une fois, il avait fallu lourdement insister.
Dans le courrier consommant officiellement le divorce, ce qui m’aura (presque) amusé, c’était la mention « Néanmoins nous tenons à vous rappeler que nous avons réalisé tout un travail autour de votre ouvrage (Maquette et intégration de corrections jusqu’au BAT définitif et communication ciblée). La maquette demeure la propriété exclusive des Éditions 1-Click1».
La maquette est établie par l’auteur, qui utilise un modèle standard. L’intégration des corrections demande, au maximum, dix minutes montre en main et café dans l’autre, d’autant que le nombre en est limité (vingt, je le rappelle). Quant à la communication, elle était et reste effectivement ciblée : comme le reste, en direction du néant. Mais c’est déjà un bel effort et j’en suis toujours, sachez-le, infiniment admiratif.
- Il suffit de regarder la couverture. [↩]


