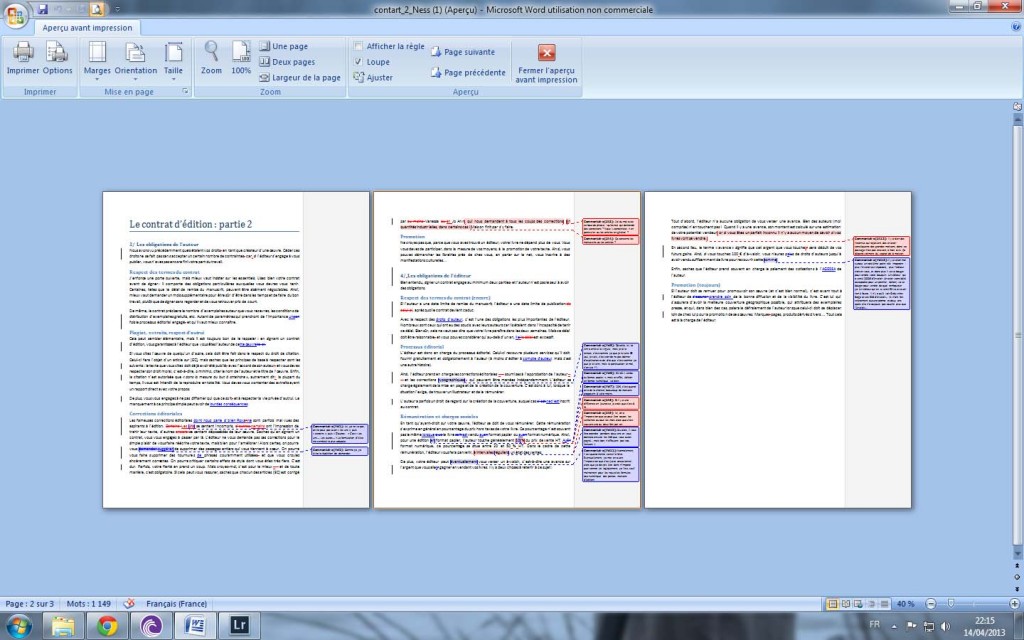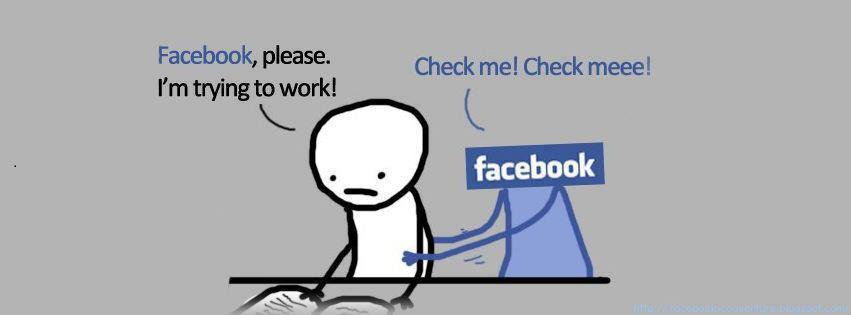2e étape : la conversion
Le moyen le plus simple revient à utiliser le site Feedbooks, à y copier/coller vos documents, à les publier gratuitement, juste le temps de récupérer les fichiers epub et Kindle, puis à les retirer du site.
C’est cependant une solution qui reste amateur, valable si vous souhaitez juste offrir un extrait de vos textes en format numérique sur votre site, mais pas si vous souhaitez vendre – les fichiers créés par ce biais comporteront la mention Feedbooks.
Je recommande de créer des fichiers sans DRM (digital rights management, verrous numériques). Les DRM empêchent en effet la conversion et la sauvegarde des fichiers ebook par les lecteurs, ce qui est préjudiciable pour ces derniers, et sont aisément contournés par les pirates de tous bords.
Amazon est le seul distributeur à permettre la conversion directement à partir de fichiers Word (.doc). Personnellement, je préfère utiliser le logiciel Mobipocket creator. Il existe un tutoriel en anglais que je recommande. Si j’utilise Mobipocket, c’est qu’il me permet de compresser au maximum mes fichiers Kindle, ce qui diminue mes « frais de livraison » à chaque vente d’ebook sur Amazon et améliore ma marge.
Vous n’êtes pas obligé(e) d’utiliser la table des matières de Mobipocket. En utilisant les feuilles de style de Word, il y a moyen de créer un sommaire comportant des hyperliens pour chaque titre de chapitre. Il n’est pas indispensable de le faire, mais cela facilite la navigation à l’intérieur du livre et c’est plus professionnel.
Il importe de remplir les champs de métadonnées quel que soit le distributeur. Les métadonnées correspondent à la signature numérique de votre fichier. Par exemple, pour un fichier de type Word, vous accédez aux propriétés pour savoir qui est le créateur du document. Les métadonnées sont un peu plus étendues : elles comprennent non seulement le nom de l’auteur, mais celui de l’éditeur s’il y a lieu, l’ISBN, la description du livre (quatrième de couverture), et parfois même la couverture, que vous pouvez y intégrer directement.
En théorie, on peut se passer des métadonnées internes au fichier epub, car tous ces renseignements, il vous faut les communiquer de nouveau dans les champs appropriés sur les sites ou fichiers excel des distributeurs concernés. Il n’est en général pas nécessaire d’intégrer la couverture de l’ebook dans les métadonnées. Attention, pour Apple, non seulement ce n’est pas nécessaire mais il ne faut pas le faire, sous peine de voir votre fichier epub refusé (oui, Apple utilise l’epub, un format commun aux PC et Mac, tout comme les fichiers .RTF).
Votre fichier de départ doit être « propre », c’est à dire que les polices de caractère prises en compte par les ebooks sont basiques, pas au-delà de la taille 14, les lettrines ne sont pas prises en compte, et les césures ne sont pas définies par vous, mais par le matériel utilisé (liseuse). Ainsi, la Kindle Paperwhite ne pratique pas la césure, là où les dernières Bookeen et Kobo proposent l’option. Dans le corps du texte de votre traitement de texte, veillez à ce que le style reste partout sur « standard », et ce afin d’éviter les surprises.
J’ai tendance à inclure une présentation de l’ouvrage (de type quatrième de couverture) au début de l’ebook (je parle ici du corps du livre), afin que le lecteur sache de quoi il s’agit s’il ne l’a plus lu depuis longtemps. Je le fais, même si j’ai déjà rentré la présentation dans le champ de métadonnées de l’ebook.
À des fins promotionnelles, je rentre aussi la description de mes autres ouvrages en fin de fichier, avec des liens hypertextes vers mon site et mon blog. Il est aussi possible de procéder à des échanges de présentation avec d’autres auteurs, afin d’essayer de « partager le lectorat ».
Pour les fichiers EPUB, auparavant, j’utilisais le logiciel Calibre couplé au logiciel Sigil. Calibre permet d’assurer une conversion de manière simple (personnellement, dans l’onglet présentation, je supprime l’interligne automatique entre paragraphes, pour resserrer le texte). Le logiciel Sigil ne travaille qu’à partir de fichiers epub déjà constitués. Il permet, avec l’onglet « Insert », puis « SGF Chapter marker », d’insérer très facilement des chapitres, puis de générer une table des matières sans avoir à le faire sous Calibre (moins fiable, selon mon expérience).
En ce moment, je bâtis mes fichiers epub directement à partir du traitement de texte que j’utilise, à savoir LibreOffice. Je continue à utiliser Sigil, mais juste pour la vérification finale de l’epub, même plus pour le chapitrage.
Pour cela, je suis allé récupérer le plugin Writer to ePub sur Internet. Puis dans l’onglet « Outils » de Libre Office, en sélectionnant « Gestionnaire d’extensions », je l’ai ajouté.
Il me suffit ensuite de créer tous mes titres de chapitres (juste les titres de chapitre, pas les chapitres entiers) à l’aide des feuilles de style en titre 1 (en limitant la police de caractère à la taille 14, les tailles supérieures n’étant de toute façon pas gérées par les ebooks) pour obtenir un chapitrage automatiquement. Je rentre les métadonnées, je laisse les préférences par défaut, je lance la conversion et c’est magique, tout se fait tout seul (l’epub est créé dans le même répertoire que celui du document converti). C’est une solution ultrasimple une fois que le plugin est installé, plus encore que de définir des hyperliens sous Word.
Et maintenant, les différents logiciels en images :