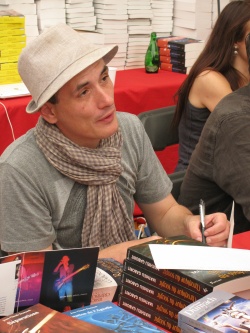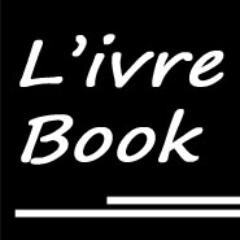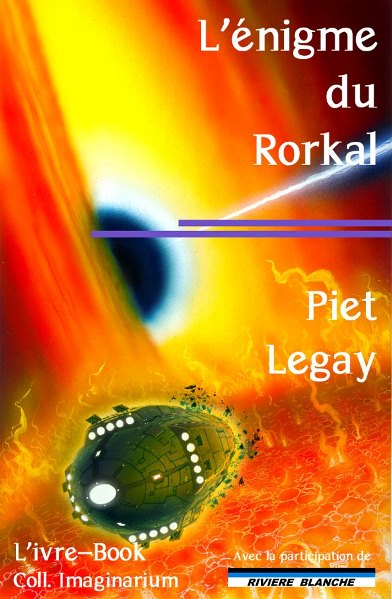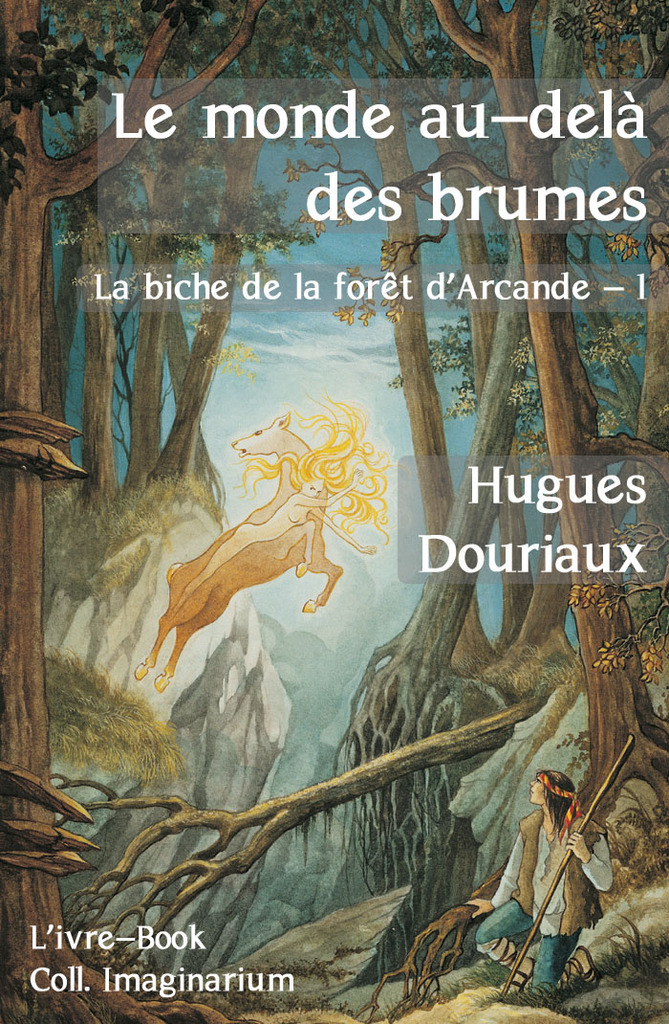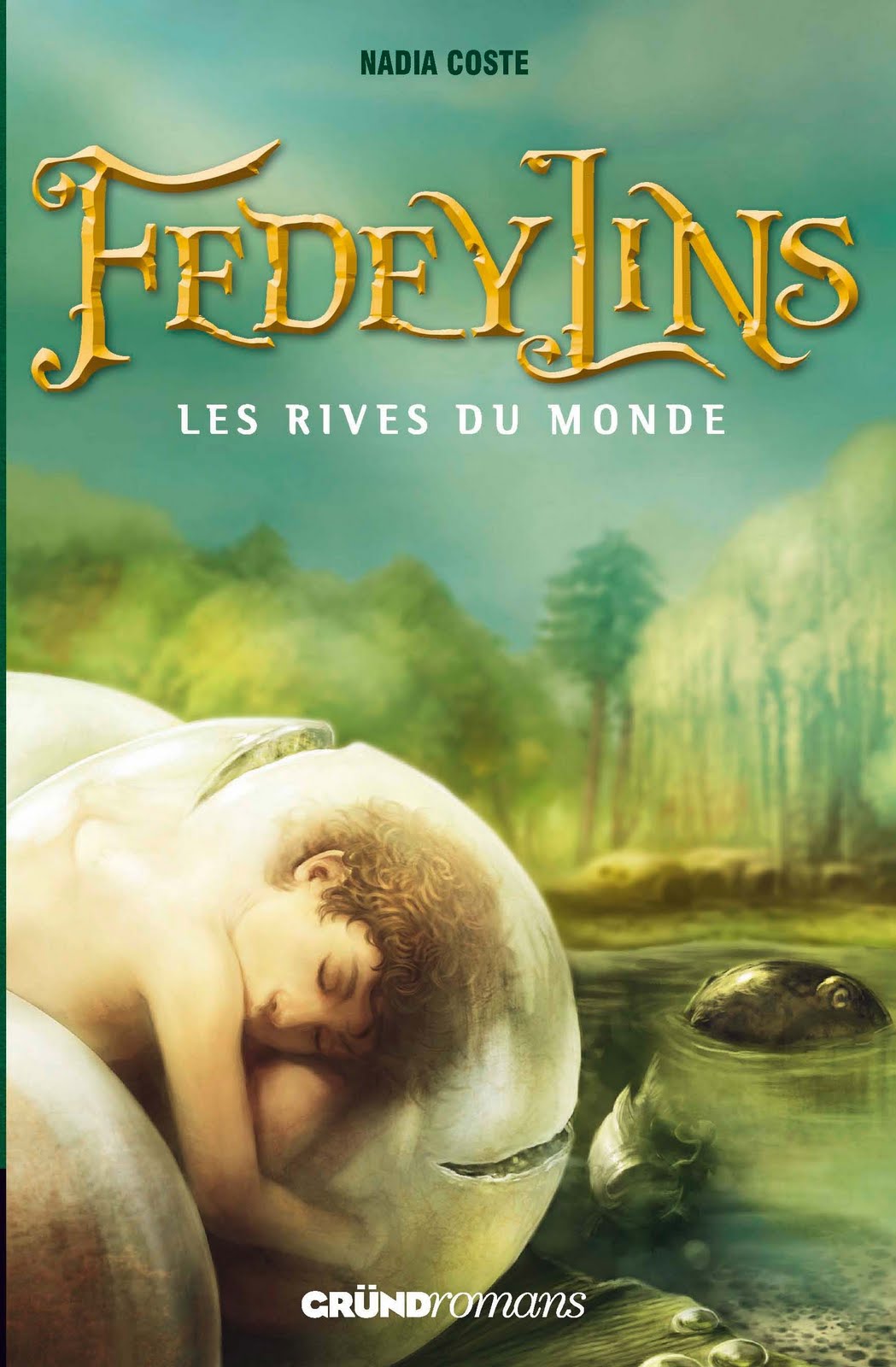(Suite de l’article publiée la semaine dernière : Et petit, vous lisiez de la fantasy ?, par Silène Edgar.)
La fantasy est aujourd’hui un genre qui occupe une place centrale dans la littérature jeunesse, mais cela n’a pas toujours été le cas. Il y a encore 20 ans, ils étaient peu nombreux, les jeunes lecteurs qui préféraient la fantasy au roman d’aventure. Il fallait être un de ces pionniers en herbe qui boudait le Club des cinq pour dévorer Bilbo le Hobbit, Moumine le troll et Histoire sans fin !
Et puis voici que l’ère de la fantasy a commencé : alors nous avons le plaisir de découvrir Lyra dans À la croisée de mondes et Harry à Poudlard ! La littérature jeunesse s’est résolument tournée vers l’imaginaire, en langue anglaise bien sûr, mais aussi en français. Voici un petit tour d’horizon de l’histoire de la fantasy francophone jeunesse !
Aux sources du genre
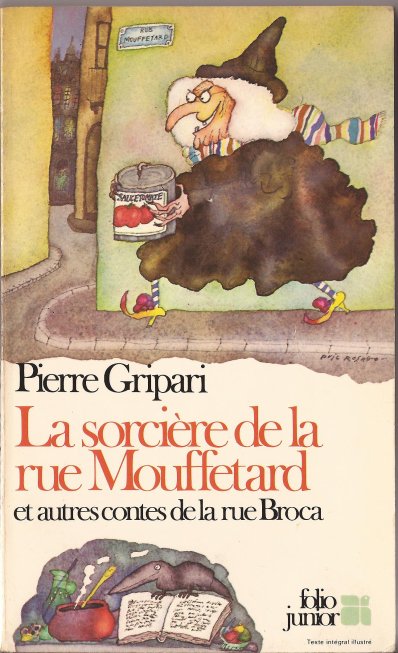 Revenons aux sources : dans la littérature jeunesse comme dans la littérature « vieillesse » (dixit Erik L’Homme), les genres de l’imaginaire ont longtemps été dévalorisés et, en jeunesse, la production francophone a été ignorée jusque dans les années 90. Pourtant, avant C.S. Lewis, l’auteur du Monde de Narnia, et Tolkien (Bilbo le Hobbit n’a été traduit qu’en 1969), les auteurs francophones de contes merveilleux ont initié leurs lecteurs, jeunes et moins jeunes, à ces univers parallèles !
Revenons aux sources : dans la littérature jeunesse comme dans la littérature « vieillesse » (dixit Erik L’Homme), les genres de l’imaginaire ont longtemps été dévalorisés et, en jeunesse, la production francophone a été ignorée jusque dans les années 90. Pourtant, avant C.S. Lewis, l’auteur du Monde de Narnia, et Tolkien (Bilbo le Hobbit n’a été traduit qu’en 1969), les auteurs francophones de contes merveilleux ont initié leurs lecteurs, jeunes et moins jeunes, à ces univers parallèles !
À la grande époque du XVIIe, Barbe-bleue le serial killer, Peau d’âne la transformiste ou le chat botté et facétieux naissaient chez Perrault tandis Mme Leprince de Beaumont créait La Belle et la Bête… Cela est un peu lointain, pensez-vous ? Vous me direz aussi que beaucoup n’ont découvert ces contes que dans leur adaptation guimauve à la Walt Disney ? Qu’à cela ne tienne, je parie que vous aviez malgré tout des livres merveilleux sur vos étagères ! Vous connaissez bien Delphine et Marinette et le Chat perché de Marcel Aymé, non ? Et si je vous parle de la sorcière de la rue Mouffetard qui voulait manger Nadia à la sauce tomate ou de sa consœur, qui logeait dans un placard à balai ? Ne chantiez-vous pas « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière » après avoir découvert le génial Gripari et ses contes de la rue Broca ? N’avez-vous pas voyagé avec André Dhôtel jusqu’au Pays où l’on n’arrive jamais ? Ah, vous voyez que vous en avez lu, petit, du merveilleux francophone !
L’explosion
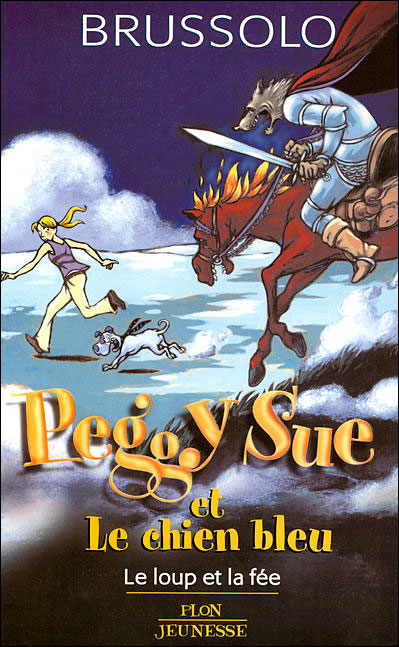 Tous ces auteurs ont été des précurseurs du genre même si ce n’est que dans les années 80 qu’il se diversifie. Apparaissent alors de nombreuses merveilles comme les romans d’Andrevon, Fetjaine, Gudule, Marie-Aude Murail et son changelin. Les jeunes lecteurs de ces années-là découvrent de nouveaux éditeurs qui entrouvrent la porte de la fantasy : Flammarion, Gallimard, Magnard, Mango, Pocket, suivis d’Albin Michel, Bayard, Hachette, Milan ou Rageot. Et avec Harry Potter, c’est l’explosion !
Tous ces auteurs ont été des précurseurs du genre même si ce n’est que dans les années 80 qu’il se diversifie. Apparaissent alors de nombreuses merveilles comme les romans d’Andrevon, Fetjaine, Gudule, Marie-Aude Murail et son changelin. Les jeunes lecteurs de ces années-là découvrent de nouveaux éditeurs qui entrouvrent la porte de la fantasy : Flammarion, Gallimard, Magnard, Mango, Pocket, suivis d’Albin Michel, Bayard, Hachette, Milan ou Rageot. Et avec Harry Potter, c’est l’explosion !
Dans les années 2000, voici que les pépites se multiplient : Bottero nous embarque aux côtés d’Ewilan tandis que Brussolo fait naître Peggy Sue et que Sophie Mamikounian crée Tara Duncan. Mourlevat fait remonter La Rivière à l’envers et Erik L’Homme nous ouvre Le Livre des étoiles. Ces livres obtiennent des succès rapides et retentissants : Le Livre des étoiles est vendu à 600 000 exemplaires et, L’Homme le dit lui-même, l’appel d’air créé par Harry Potter, publié aussi chez Gallimard jeunesse, a été une grande opportunité pour les auteurs francophones.
Une offre diversifiée
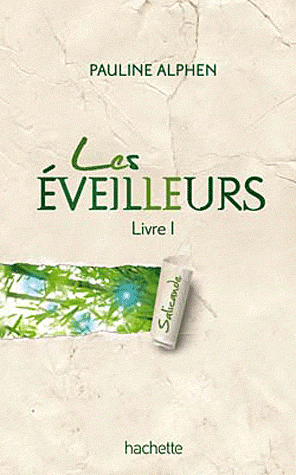 Par la suite, le genre s’installe et perce au fur et à mesure dans toutes les maisons : ainsi, L’école des Loisirs, résolument réaliste (à la notable exception de Loïs Lowry, en SF), offre la joie de découvrir Björn le Morphir de Thomas Lavachery à travers une saga délirante, qui nous plonge dans l’univers des vikings. Dans la suite de la saga, nous visitons des Enfers vikingo-romains dans une perspective toute aussi imaginative que celle de Pullman dans le tome 3 d’À la croisée des mondes : c’est une belle démonstration de la façon dont la fantasy se saisit de la littérature classique et la renouvelle. Dernièrement, les éditions Thierry Magnier, connues pour la qualité de leurs choix dans la littérature réaliste, se sont aussi ouvertes à l’imaginaire avec Samien de Colin Thibert, inspiré par le roman picaresque. Tous ces auteurs explorent de nombreuses pistes, et si nous nous référons aux catégories qu’André-François Ruaud définit clairement dans sa Cartographie du merveilleux, il y en a pour tous les goûts : fantasy héroïque, fantasy urbaine, fantasy historique, féerique, animalière, etc.
Par la suite, le genre s’installe et perce au fur et à mesure dans toutes les maisons : ainsi, L’école des Loisirs, résolument réaliste (à la notable exception de Loïs Lowry, en SF), offre la joie de découvrir Björn le Morphir de Thomas Lavachery à travers une saga délirante, qui nous plonge dans l’univers des vikings. Dans la suite de la saga, nous visitons des Enfers vikingo-romains dans une perspective toute aussi imaginative que celle de Pullman dans le tome 3 d’À la croisée des mondes : c’est une belle démonstration de la façon dont la fantasy se saisit de la littérature classique et la renouvelle. Dernièrement, les éditions Thierry Magnier, connues pour la qualité de leurs choix dans la littérature réaliste, se sont aussi ouvertes à l’imaginaire avec Samien de Colin Thibert, inspiré par le roman picaresque. Tous ces auteurs explorent de nombreuses pistes, et si nous nous référons aux catégories qu’André-François Ruaud définit clairement dans sa Cartographie du merveilleux, il y en a pour tous les goûts : fantasy héroïque, fantasy urbaine, fantasy historique, féerique, animalière, etc.
Et il y en a pour tous les âges ! Les petits découvrent ainsi, avec Claude Ponti, des univers délirants. Les collégiens se régalent des Éveilleurs de Pauline Alphen, L’Elfe au dragon d’Arthur Ténor ou les romans des St-Chamas avec la série Strom. Les lycéens peuvent facilement aller vers la fantasy adulte grâce à des ouvrages passerelle comme ceux de Mathieu Gaborit, si connu des rôlistes à travers Agone ou Pierre Pevel avec Les Lames du cardinal et le cycle de Wielstadt. Il semble oublié le temps où Mathieu Gaborit, Gérard Guéro, Pierre Pevel et Stéphane Marsan, qui sont loin pourtant d’être des vieillards chenus, ne trouvaient, petits, que les classiques anglo-saxons ou les contes anciens pour nourrir leur imaginaire. La naissance de la fantasy jeunesse en France est récente, mais elle ressemble bien plus à une explosion qu’à une timide arrivée.
Les francophones à l’égal des anglophones ?
Malgré une prédominance manifeste des anglo-saxons, les francophones font de beaux succès dans les librairies, il suffit de citer Strom, Louis le Galoup et Oksa Pollock. Les grands succès ne se démentent pas dans le temps, par exemple Tobie Lolness, sorti en 2006, dont les droits ont été achetés pour une adaptation cinématographique, ou Les Chevaliers d’Émeraude de la québecoise Anne Robillard, adapté aujourd’hui en BD. Le Combat d’hiver de Mourlevat est traduit en 11 langues. Les éditeurs mettent le paquet en choisissant le plus souvent une publication en grand format, ce qui leur permet de les re-exploiter ensuite en poche, mais surtout de créer un étal particulier, celui qui vous saute aux yeux quand vous arrivez au rayon jeunesse : 50 % des grands formats sont des romans de fantasy et ils représentent 65 % des ventes (Ipsos 2006). Les concepteurs marketing rivalisent d’imagination pour créer la couverture originale qui attirera l’œil dans cette marée de « gros pavés ». Les maisons spécialisées SFFF ont des collections jeunesse, et elles y accueillent les francophones largement : nous pouvons ainsi lire Danielle Martinigol et Carina Rozenfeld à L’Atalante, Emmanuelle Nuncq et bientôt Mel Andoryss et Lise Syven chez Bragelonne, etc.
Est-ce que, pour autant, on peut imaginer que la fantasy francophone se suffise à elle-même pour satisfaire le lectorat ? Je pense par exemple à la collection créée chez Mango, Royaumes perdus, qui explorait le merveilleux à travers les âges, de la Rome antique aux steppes russes, et ne proposait que des titres francophones. Ce n’est pourtant pas une question de qualité des ouvrages : on y retrouvait les grands noms, Johan Heliot, Fabien Clavel, Christophe Lambert, et les romans étaient de vraies pépites. Même revers pour Le Pré aux clercs pour la belle collection YA francophone Pandore, lancée en 2012 et qui nous avait permis de lire par exemple Estelle Faye. Là encore, cette fermeture est sans rapport avec la qualité des ouvrages ni avec l’intérêt du genre. Est-ce que les collections étaient trop spécialisées ? Ou est-ce que les éditeurs ont besoin des grosses locomotives américaines (en général les adaptations cinématographiques) pour financer les sorties francophones moins médiatisées ? Question à suivre dans les années à venir.
Quoiqu’il en soit, un petit tour aux Imaginales au mois de mai permet de mesurer l’incroyable vitalité du secteur. Sans attendre jusqu’en mai, il suffit de regarder les étals chez les libraires pour constater que la fantasy jeunesse a de l’avenir : des vampires aux loups-garous en passant par les zombies, la magie n’est pas près de disparaître ! Et les francophones y sont bien installés comme le prouve une jeune auteur comme Samantha Bailly, étoile montante de la fantasy francophone !