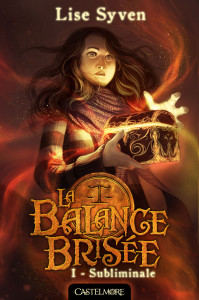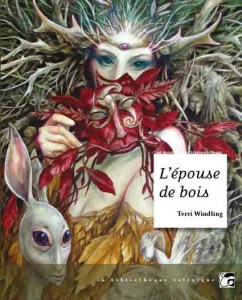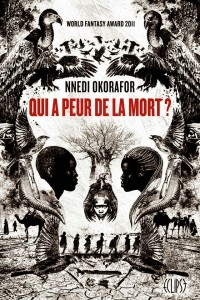Suite et fin de l’article de Valéry K. Baran et Hope Tieffenbrunner.
6/ Être extrêmement vigilant avec les sujets casse-gueule
Quʼil vous faudra généralement aborder pourtant.
En M/M, ils sont au nombre de trois, pour les principaux : la découverte de ses tendances homosexuelles, le viol et lʼhomophobie.
Concernant le premier, laissez tomber tout de suite les « je ne suis pas gay mais avec toi ce nʼest pas pareil parce que je tʼaime, et puis couchons ensemble dʼailleurs ». Ce nʼest pas réaliste et ça ne le sera jamais. Un personnage ne peut pas se découvrir homosexuel du jour au lendemain sans que jamais dans sa vie auparavant, il nʼait ressenti ne serait-ce que le moindre trouble pour un autre homme. Il aura peut-être eu du mal à se lʼavouer, et il peut y avoir un travail à lui faire faire à ce sujet (hautement casse-gueule, mais cʼest faisable), mais en aucun cas, jamais, il ne passera de « je suis totalement hétéro, il nʼy a eu jamais aucun signe antérieur » à « oh, tiens ! Je suis finalement homosexuel, allez, couchons ensemble ».
Par ailleurs, à partir du moment où il a une attirance sexuelle pour quelquʼun du même sexe que lui, il ne peut pas se dire : « je ne suis pas homosexuel, cʼest juste toi » (ou alors offrez-lui un dictionnaire et lisez-lui à voix haute la définition du mot homosexualité). Et, si vous abordez le sujet délicat de la première fois homosexuelle pour un homme nʼayant eu que des rapports hétérosexuels, il va falloir aborder comme il le faut ce quʼil ressent par rapport à ça. Ce nʼest pas anodin.
Enfin, si votre personnage, nʼayant vécu que des relations hétérosexuelles jusque-là, éprouve du désir pour un homme, il nʼa pas forcément à se dire quʼil est soudainement devenu homosexuel, mais plutôt quʼil est bisexuel. Eh oui.
En deux : le viol. Avant même de penser à en mettre un, réfléchissez ! Cet acte n’est pas anodin, que la victime soit un homme ou une femme et quel que soit l’agresseur. Ne participez pas à la banalisation dʼun acte dʼune telle gravité. Est-ce vraiment le seul ressort scénaristique qui vous vient à l’esprit ? Est-ce vraiment important pour l’histoire ? N’est-ce pas une solution de facilité ? Si la réponse est oui, réfléchissez encore. Si vraiment vous y tenez, prêtez extrêmement attention à la façon dont vous allez aborder ensuite les rapports : exit le rapport méga hot peu après. Bonjour, le travail sur la psychologie et la reconstruction de votre personnage. Il faudra laisser passer du temps après l’agression et, surtout, surtout, ne négliger à aucun moment cet élément extrêmement important lorsque vous décrirez le premier rapport sexuel qui se déroulera après: celui-ci ne peut se faire que sous la présence, en fond, de ce viol vécu.
En trois : lʼhomophobie. Renseignez-vous bien avant dʼécrire certaines choses (exemple : en France, on nʼinterdit jamais aux compagnons de personnes hospitalisées de leur rendre visite, quʼils soient dans un couple hétérosexuel ou homosexuel) et, là encore, évitez à tout prix les clichés.
7/ Ne jamais se forcer à mettre ou ne pas mettre une scène de sexe explicite
Comme nʼimporte quelle scène, sa présence doit être justifiée.
Si vous n’aimez pas les détails et préférez quand la caméra s’arrête sur un fondu avant le lendemain matin, pourquoi vous forcer à écrire une scène que vous ne voulez pas sous prétexte que ça « vendra » plus ? Si vous ne prenez pas plaisir à la faire, il y a fort à parier que votre lecteur le ressentira d’une façon ou d’une autre.
A contrario, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, ne vous retenez pas !
8/ Rester cohérent et réaliste dans cette scène de sexe
En terme de vocabulaire, déjà ! Même si c’est possible, comprenez que, si jusque-là vos personnages n’utilisaient pas de vocabulaire extrêmement cru, ça peut être déstabilisant pour vos lecteurs s’ils se mettent soudain à parler comme dans un porno.
En parlant de porno, respectez aussi l’expérience des personnages, ce qui est valable en M/M comme dans n’importe quelle romance : pas de vierges qui se transforment en véritable acteur du genre.
Ensuite en terme de caractéristiques physiques. Pour éviter de rentrer dans les détails, parce quʼil y aurait beaucoup à dire, vous pouvez lire les guides que nous avons déjà rédigé à ce sujet il y a quelques années, soit le Guide du gay-sex où vous trouverez toutes les informations utiles pour écrire des scènes de sexe réalistes, et le Guide du lemon yaoi pour des conseils plus larges relatifs à lʼécriture dʼune scène de sexe.
9/ Ne pas omettre le safe sex
En premier lieu lʼusage du préservatif. Ça sʼinsère en deux seconde dans un texte et ça nʼa absolument rien dʼun élément cassant lʼaspect « torride » de la scène, comme le craignent parfois certains auteurs. Vous pouvez même vous en servir comme un élément vous permettant de traduire lʼempressement des personnages.
Si vraiment vous ne parvenez pas à lʼintroduire dans votre histoire/si ça vous est trop difficile, mettez un mot à ce sujet avant ou après votre histoire pour au moins informer vos lecteurs que, dans la réalité, il faut absolument se protéger.
Lorsque lʼon vend des histoires dʼamour rêvées à des lecteurs, histoires auxquelles ils vont sʼidentifier, il est important de faire en sorte de ne pas leur donner pour idéal, pour rêve, une situation dans laquelle ils vont mettre leur vie en danger. Et il est important de rappeler que certains jeunes lecteurs font leur éducation sexuelle en lisant vos histoires. Ne les mettez donc pas en danger.
Si vous écrivez du BDSM, il faut impérativement respecter les règles minimales de précaution. La base étant le safeword et la règle de base : sane, safe and consensual, à graver dans son esprit. Tout ce que vous pourriez écrire ne respectant pas ces principes de base ne sera pas du BDSM mais des pratiques inquiétantes et dangereuses.
10/ Nʼécrivez pas de romance M/M
Ecrivez une romance. Tout court. Et même pas : écrivez juste une histoire, avec des vrais personnages, un vrai univers, pas de caricatures, des personnages justes et cohérents, pas de raccourcis, des dialogues crédibles, des comportements expliqués et justifiés.
Bref, oubliez que vous écrivez une romance M/M, écrivez juste une bonne histoire.
Éclatez-vous !