Le premier week-end de novembre, alors que pleins de nanoteurs commençaient avec fièvre leur NaNoWriMo, d’autres auteurs, lecteurs, et autrement férus de science-fiction se donnaient rendez-vous à Nantes pour la quinzième année consécutives. Aux Utopiales.
Qu’est-ce que c’est, les Utopiales ?
Une zone de rencontres et d’échanges autour de la science-fiction (surtout), quel que soit son médium (jeu vidéo, romans, bande-dessinés et/ou films), et qui s’ouvre aussi sur la science (actualités et quelques projets innovant de l’INSERM ou de l’agence spatiale) et des fois, au détour d’une conversation, les termes de fantasy ou de fantastique sont évoqués.

Et il y a les invités. Des grands noms de la science-fiction francophone (française souvent) comme Pierre Bordage, Alain Damasio ou Gérard Klein…, et des invités étrangers, qui parlent en anglais (et certains ont plus ou moins du mal) comme cette année Orson Scott Card !
Les invités participent à des tables rondes, ou des « rencontres » (interviews), pour une heure. Comme il y a trois espaces de débats différents, souvent, on doit choisir ce qu’on veut faire. Sans compter, qu’en même temps, des films sélectionnés par l’équipe des Utopiales sont projetés dans deux salles différentes. Encore des choix en perspective !
Les invités sont aussi présents dans la librairie éphémère montée spécialement pour les Utopiales par l’association des Librairies Complices. Si le vendredi (1er novembre, férié), les auteurs étaient assaillis par leur fans, on pouvait remarquer autour du samedi après-midi, la foule était beaucoup plus parsemée.
[minute groupie on]J’ai pu discuter avec Orson Scott Card, comme il n’avait plus personne à sa table ![/minute groupie off]

Ça, c’est facile à expliquer, c’est ce qui est vendu sur leur site et leur plaquette, mais ce serait vraiment dommage de réduire une zone de rencontres à juste un cadre organisé. Parce que les Utopiales, c’est avant tout des rencontres, des projets et des passions. Ce n’est pas seulement d’assister en spectateurs muets à des grands discours.
C’est aussi de repérer une tête connue dans la foule, près du bar de Mme Spock, et de voler un canapé à un autre groupe, pour poser les questions fondamentales « Et alors, tu fais quoi en ce moment ? » et également de raconter les difficultés, les bonheurs ou les idées qui viennent d’arriver.
C’est aussi d’être en train de discuter avec une personne et qu’elle s’interrompt pour faire la bise ou simplement un signe de la tête à une personne inconnue qui ne fait que passer. Puis de demander, avec grande curiosité (on peut être timide, mais il faut cultiver sa curiosité, c’est très important) « C’est qui, dis ? », puis d’apprendre que c’est la responsable de la presse pour les éditions Atalante, ou le responsable de telle édition ou de telle collection.
On peut aussi remarquer que des projets s’approfondissent. En général, cela se remarque par deux ou trois personnes dans un coin, en train d’argumenter assez fortement, un cahier déjà bien gribouillé dans la main d’un d’entre eux.

Plein de groupes de tailles différentes se retrouvent (sur l’heure du repas, mais aussi à d’autres moments !). J’aimerais savoir la teneur des discussion. Au pif, je dirais : 25 % de projets, 25 % de lectures à échanger, 25 % de remarques sur les Utopiales et 25 % du reste.
De manière générale, les rencontres, festivals ou salon, c’est toujours la même chose, tant qu’un espace est clairement prévu pour la discussion et d’autres pour apprendre des choses. Il y a des expositions (pour cette année, les expositions des Utopiales étaient très – trop – proches de celle de l’année dernière), des stands où parlent des passionnés, et des livres, plein de livres à acheter (toujours) et à faire dédicacer (quand c’est possible). Il y a des auteurs inconnus mais très sympas, qui acceptent de discuter avec les visiteurs. Il y a des auteurs étrangers qui essaient de dire quelques mots dans un français hésitant pour amorcer un dialogue avec un lecteur. Et il y a des lecteurs. Une foule de lecteurs qui peut très bien conseiller le nouveau roman de tel auteur qui est si bien, si génial.
Les Utopiales, c’est un endroit où on arrive quasiment les mains dans les poches (surtout si comme moi, on n’a pas regardé les auteurs présents en dédicace) et où on repart en croulant sous les livres.
Sauf si on s’appelle JC Dunyach, mais ça, c’est une autre histoire.

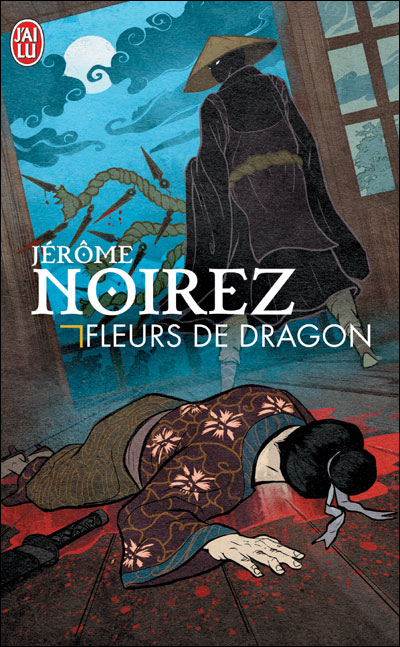 Salut à tous !
Salut à tous ! Dans la série, « un an d’[EC] », je tenais à répondre en toute sincérité à ces questions parfois étranges que vous vous posez et qui vous amènent sur notre site. (Top des recherches les plus bizarres qui aboutissent sur espacescomprises.com…)
Dans la série, « un an d’[EC] », je tenais à répondre en toute sincérité à ces questions parfois étranges que vous vous posez et qui vous amènent sur notre site. (Top des recherches les plus bizarres qui aboutissent sur espacescomprises.com…)