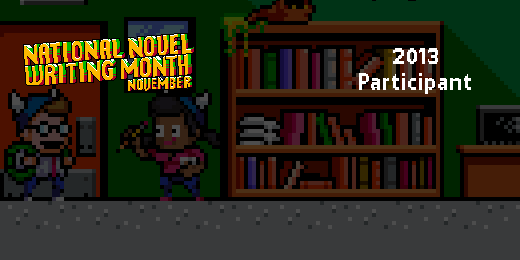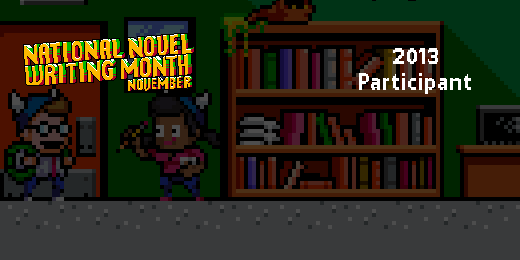
Pour plus de 300 000 écrivains, professionnels ou amateurs, dans le monde entier, s’approche le mois le plus déluré de l’année d’écriture : novembre. Eh oui, c’est NaNoWriMo ! Déjà ! Sur [Espaces Comprises], nous vous avions présenté le défi l’année dernière, ainsi que les deux premiers nanoromans francophones publiés :
Depuis cet article, d’autres livres sont sortis :
- L’Ouroboros d’argent d’Ophélie Bruneau (NaNoWriMo 2010, Éditions du Chat Noir 2013) ;
- La saison 1 de Passeurs d’ombre (Camp NaNoWriMo 2012, Numeriklivres 2012), Une démone chez les anges (NaNoWriMo 2011, Éditions Sortilèges 2013) et Suzy online (NaNoWriMo 2011, Éditions Les Lucioles 2013), tous les trois d’Anne Rossi ;
- Les Épreuves de l’amour de Deirdre Campbell (NaNoWriMo 2011, Éditions Láska 2013) ;
- L’Agence de Suzanne Vanweddingen (NaNoWriMo 2011, Rryozz Éditions 2013) ;
- Et, dernier, mais pas des moindres : Naturalis de notre Franck Labat, aka Mr Tagada (NaNoWriMo 2011, Éditions Prisma 2013) !
Cela ne s’arrête pas là, puisque dans les mois qui viennent, il y aura également :
- Lacrimosa d’Alice Scarling (NaNoWriMo 2012, Milady 2014) ;
- Outrepasseurs 1 de Cindy Van Wilder (NaNoWriMo 2008, Gulfstream 2014) ;
- Le Dernier Train de Suzanne Vanweddingen (NaNoWriMo 2005, Rryozz Éditions 2014) ;
- Aujourd’hui ne se termine jamais de Jo Ann von Haff (NaNoWriMo 2008, Éditions L’ivre-Book 2014) (notez la discrétion).
Maintenant que le récapitulatif est fait et que vous êtes face à des gens qui ont su profiter de l’ambiance de folie de novembre pour lancer des projets (nous reparlerons de corrections et réécritures au moment voulu) viables, voici les quelques conseils que nous (survivants, vétérans, kamikazes) pouvons vous donner.
DEUX SEMAINES AVANT NANOWRIMO
→ Si vous êtes du genre à faire des plans/des synopsis : Maintenant est le bon moment pour vous lancer. On est à quelques jours du top départ, l’attente ne sera pas longue et votre tête arrivera fraîche au moment de commencer à écrire, les idées seront encore présentes et non plus un lointain souvenir (comme lorsqu’on se prépare en juillet…) ;
→ Si votre sujet est pointu : Faites vos recherches avant novembre. Pendant le défi, vous aurez autre chose à faire que de vérifier des références ou d’aller chercher telle définition ou apprendre à piloter un hélicoptère (on n’est pas dans Matrix, il n’y a pas une application pour ça). Il y a pourtant une autre raison de faire vos recherches avant : parfois, les recherches peuvent aider dans la maturation des idées, donc la réalisation des plans (si tant est que vous en fassiez).
→ Si vous vivez en famille, en colocation : Préparez votre entourage à votre absence. Vous serez sous le même toit, mais vous ne serez plus tout à fait là. Vous serez une sorte de zombie, auteur de l’extrême. Préparez une messagerie vocale, au cas où.
→ Si vous travaillez à l’extérieur (si vous ne télétravaillez pas, si vous n’êtes pas à votre compte, etc.) : Le premier jour de Nano est toujours un jour férié (souvent un week-end, voire même un week-end prolongé). Mettez à profit ces premiers jours. Si vous le pouvez, rentabilisez vos RTT et vos congés. Si, si. Il y a des gens qui n’ont peur de rien.
DEUX JOURS AVANT NANOWRIMO
→ Si vous êtes des gens qui vous shootez à chaque séance d’écriture : Stockez vos drogues : café, thé, chocolat, fraises Tagada (pour Mr Tagada), Coca (guaraná pour moi, merci)… Soyez sûrs que personne ne touche à votre réserve. En novembre, on écrit, on ne fait pas de courses.
→ Si vous écrivez à la main (parce qu’il y en a !) : Achetez un nouveau cahier, achetez dix stylos (au moins). Si vous préférez le crayon, achetez-en au moins dix. Si la mine se casse, passez au suivant. Tailler un crayon ? C’est du luxe.
LA VEILLE DU NANOWRIMO
→ Si vous portez les ongles longs et tapez sur un clavier (parce qu’il y a ceux qui écrivent à la main) : Coupez-les ! Cela peut paraître bête, comme ça, mais pensez aux pianistes qui se coupent les ongles à ras. Vous taperez au moins 1,5 fois plus vite et, bonus, vous aurez moins mal aux doigts à la fin d’une séance d’écriture intensive. Recommencez toutes les semaines.
À TRENTE MINUTES DU NANOWRIMO
Embrassez votre entourage et dites-leur « à décembre » !
PENDANT LE NANOWRIMO
Il vous faut 1667 mots par jour pendant 30 jours pour atteindre le Graal (= un badge qui en plus est moche, cette année).
→ Donnez-vous une marge de manœuvre : Essayez d’écrire 1 700, voire 1 800 mots par jour. Cela paraît peu comparé au quota journalier, mais cela vous donnera un, voire deux jours d’avance. Ne prévoyez jamais de terminer à 23 h 58 le 30 novembre. À cette heure-là, des centaines de milliers de nanauteurs sont en train de valider leurs mots et vous apprendrez, dans la douleur, que le site de NaNoWriMo n’échappe pas aux pannes impromptues…
→ Ne vous arrêtez pas au milieu d’une scène : Même si vous avez atteint votre quota, ne vous arrêtez pas au milieu de la scène en cours : continuez !
→ Si vous sentez que vous pouvez continuer, n’hésitez pas : Il y a des jours où, miracle/inspiration/motivation/etc., vous pourrez aller au-delà de votre moyenne. Alors profitez-en ! On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. On a beau avoir assuré ses arrières, il y a toujours des imprévus, il y a encore une vie en dehors de NaNoWriMo (sacrilège !). Avoir le double de mots « de rab’ », c’est un peu comme avoir une assurance écriture, voyez ?
→ Sur le web : profitez des Word Wars : Les Word Wars consistent à écrire le plus de mots possible pendant une durée de 15 ou 30 minutes. Mettez-vous à plusieurs pour vous motiver, sur le chat, les réseaux (Facebook et Twitter) ou le forum !
→ IRL : profitez des Write In : Si vous êtes dans une ville où vous pouvez rencontrer des Nanauteurs, n’hésitez pas ! Faites-vous des Write In, des séances d’écriture, souvent dans un café où le wifi est disponible, dans une librairie ou chez quelqu’un. Plus on est de fous, plus on écrit (non ?).
→ Vous avez tendance à procrastiner : Alors coupez internet, quitte à enlever le boîtier de la prise ! Donnez-vous un objectif : tous les 500 mots, faites une pause de 10 minutes, puis recommencez. Offrez-vous un restaurant après avoir atteint les 10 000 mots. Il n’y a rien de mieux qu’une carotte. (Il y a peut-être le chocolat.)
→ Ne corrigez pas ! Mettez-vous en tête que novembre = écriture ! Comme disent les Anglos : kill the inner editor ! Il y a un temps pour tout. Corriger vient après écrire (dans la logique).
→ IMPORTANT : le NaNoWriMo est un défi personnel : On ne le dira jamais assez : le NaNoWriMo n’est pas une compétition. C’est un défi personnel ; votre but, à vous, est d’écrire 50 000 mots à votre vitesse, que cela prenne une semaine ou tout le mois. Quitte à suivre les avancées des autres participants, utilisez-les comme un autre genre de carotte (ou de chocolat).
APRÈS LE NANOWRIMO
Félicitations ! Vous avez survécu !
→ Si vous avez terminé votre roman (peu importe le nombre de mots) : Rangez votre manuscrit, laissez-le reposer quelques semaines (le mieux serait quelques mois). Ce n’est pas la peine de vous plonger dans les corrections dès décembre si vous n’avez pas de délais à respecter. Vous êtes encore dans votre histoire et vous aurez plus de mal à améliorer votre texte.
→ Si vous n’avez pas terminé votre roman (peu importe le nombre de mots) : Posez-vous quelques jours avant de reprendre. Il est toujours mieux de battre le fer lorsqu’il est encore chaud, alors c’est le moment, avec des horaires/quotas plus humains. Une heure/500 mots par jour.
Dans tous les cas, bravos, vous êtes un guerrier !
Et réapprenez à vivre en communauté. Ce sera nécessaire.
 Nous savons déjà que le bébé-auteur vit dans un monde à part. Il a parfois folies des grandeurs, mais il sait être humble lorsqu’il s’agit de se lancer dans l’édition, cet univers impitoyable (je sais que vous avez le générique en tête, maintenant. Ne me remerciez pas). Mais à force de vouloir être humble, le bébé-auteur devient bébé-pigeon.
Nous savons déjà que le bébé-auteur vit dans un monde à part. Il a parfois folies des grandeurs, mais il sait être humble lorsqu’il s’agit de se lancer dans l’édition, cet univers impitoyable (je sais que vous avez le générique en tête, maintenant. Ne me remerciez pas). Mais à force de vouloir être humble, le bébé-auteur devient bébé-pigeon.

 Bonjour à tous !
Bonjour à tous !