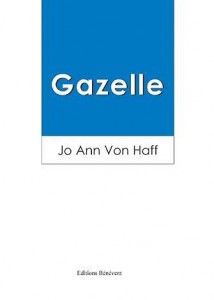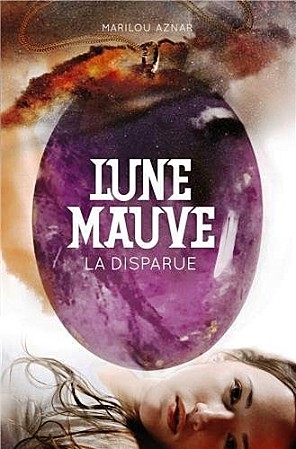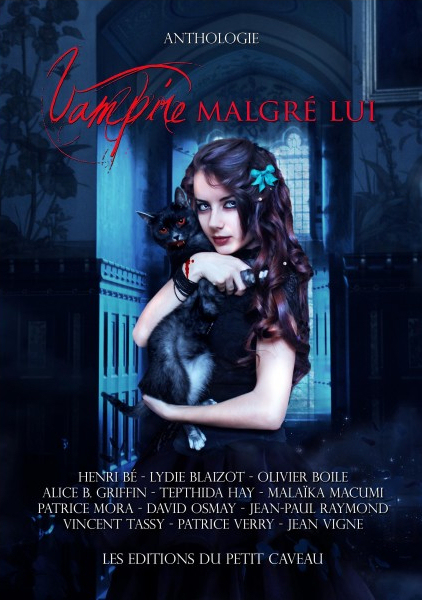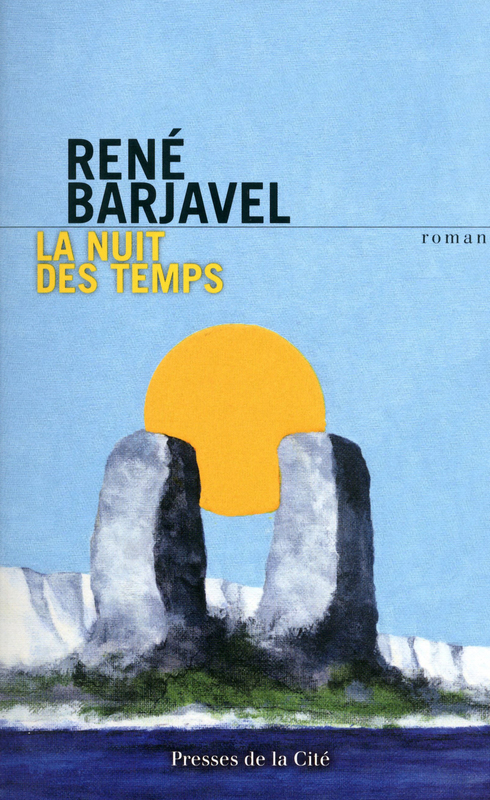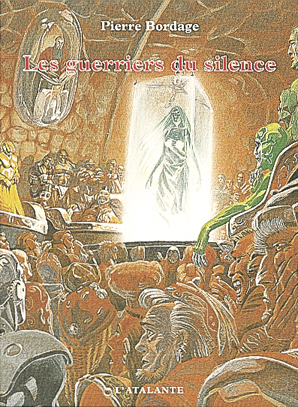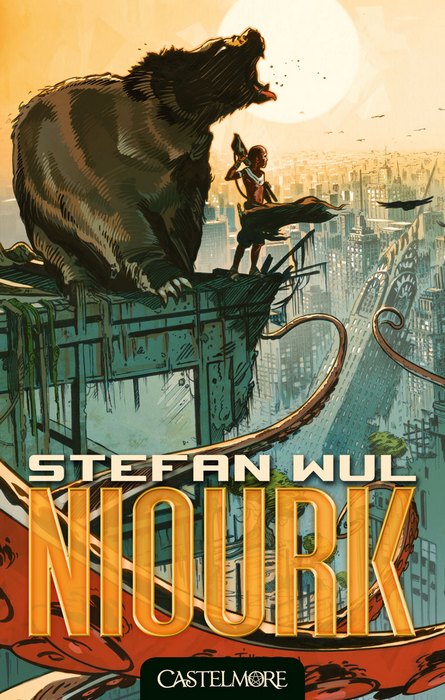La recherche d’un éditeur est une étape importante dans la vie d’un manuscrit et dans celle de son auteur. Cette démarche est source de confusion pour les nombreux « galériens de l’écriture » qui débarquent pleins de bonne volonté, mais complètement perdus face à tout ce qu’ils peuvent trouver sur le marché. Cet article n’a pas pour but de vous donner la recette magique – sinon, vous vous doutez bien que j’aurais publié bien plus de mes œuvres ! –, mais de vous aider à vous poser les bonnes questions, soumettre votre texte aux bonnes personnes.
1/ Quelle est la ligne éditoriale de l’éditeur ?
On n’envoie pas son manuscrit à un panel aléatoire d’éditeurs ! Le choix d’un éditeur, ce n’est pas du « pifomètre ». Chaque maison a ses préférences, ses exigences, ses points rédhibitoires, tout un ensemble de critères qui forme ce qu’on appelle « la ligne éditoriale ». Deux critères sont prépondérants : le genre littéraire (SFFF, essais politiques, livre de cuisine, etc.) et le public (jeunesse, YA, adulte) auquel s’adresse un texte.
Généralement, il n’est pas difficile de savoir quelle est la ligne éditoriale d’un éditeur. Un petit tour sur son site internet, dans la catégorie « présentation » suffira. C’est là que vous trouverez tous les renseignements qui vous seront nécessaires. Si jamais cette section ne répond pas à vos questions, une fois de plus, contactez l’éditeur qui pourra vous fournir des réponses. Évidemment, lire les romans publiés par un éditeur reste le meilleur moyen de connaître sa ligne éditoriale.
Avant d’envoyer votre manuscrit à qui que ce soit, déterminez à quel genre il appartient et à qui il s’adresse. Cela vous permettra de sélectionner les maisons d’édition appropriées dans la ligne éditoriale desquelles votre manuscrit peut s’insérer.
2/ Quel type de contrat est proposé ?
Compte d’auteur, compte de lecteurs ou compte d’éditeur ? C’est cette distinction qui doit vous guider.
- Un éditeur qui publie à compte d’auteur vous demandera de payer pour la publication, totalement ou partiellement.
- Un éditeur à « compte de lecteurs » vous demandera généralement un certain nombre de préventes minimum pour éditer votre manuscrit. Ce seront ces préventes qui financeront ensuite le processus éditorial. Je ne saurais que trop vous déconseiller ces modes de publication. Si un éditeur refuse d’investir ses propres fonds dans la publication, soit le texte n’est pas bon – et dans ce cas il ferait mieux de vous le dire, pour que vous puissiez le retravailler avant de subir les critiques pas toujours tendres des lecteurs –, soit l’éditeur se fiche complètement de la qualité des livres qu’il produit et n’a qu’un seul objectif : faire rentrer de l’argent.
- Un éditeur à compte d’éditeur investira ses deniers personnels dans votre manuscrit. Dans ce monde bassement matérialiste où tout se paie, ça peut sembler incroyable. Quelqu’un investirait, par pur intérêt pour votre texte, une somme conséquente afin de le publier ? C’est pourtant vrai. Néanmoins, ne vous faites pas d’illusions. Si un éditeur investit, c’est qu’il espère rentrer dans ses fonds. Il sera donc exigeant envers vous et vous demandera sans doute de retravailler votre texte, non pas parce qu’il se fait un malin plaisir de « dénaturer votre art », mais parce que c’est un professionnel qui a un regard pointu et sur les œuvres littéraires, et que son point de vue extérieur lui permet de mettre le doigt sur les incohérences et faiblesses qui desservent votre manuscrit.
Au final, l’idéal est de demander un exemplaire-type du contrat si possible. Sinon, épluchez le site internet de l’éditeur ou bien appelez-le afin d’être sûr qu’on ne vous demande pas de payer. Consultez également les forums et les blogs : les auteurs parlent beaucoup entre eux et vous pouvez trouver des témoignages qui vous aideront à prendre une décision. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse claire, n’envoyez pas votre manuscrit.
3/ Quelles sont les méthodes de travail de l’éditeur ?
C’est-à-dire, quel travail effectue-t-il sur votre manuscrit et par quels prestataires passe-t-il pour cela ?
Avant la publication, votre texte doit être réécrit par vos soins, sans doute plusieurs fois, selon les indications généralement fournies par l’éditeur lui-même ou par son comité de lecture. Une fois la version définitive du récit adoptée, le texte doit être corrigé sur la forme, normalement en étant transmis à un correcteur professionnel. À vous ensuite de reporter les corrections qu’il vous a suggérées. Dans le même temps, l’éditeur doit créer une couverture, souvent avec un graphiste et un illustrateur, et rédiger un texte de quatrième de couverture.
Ces étapes sont nécessaires à la bonne promotion et diffusion de votre manuscrit, elles permettent de proposer au lecteur un produit fini de qualité et faire l’impasse sur l’une des étapes peut être préjudiciable. Or il est rare qu’un éditeur puisse tout faire tout seul, c’est pourquoi il fait souvent appel à des prestataires extérieurs.
Toutes les personnes qui interviennent au cours du processus éditorial – lecteur, correcteur, graphiste, illustrateur – sont normalement rémunérées. Il est de plus en plus courant que de jeunes maisons d’édition fassent appel au bénévolat pour cela, mais j’insisterai sur un point : être correcteur, lecteur, graphiste ou illustrateur est un métier à part entière. C’est une formation, des compétences, du temps et du travail investis dans les manuscrits et dans leur réussite. Si un éditeur déprécie toutes ces personnes – grâce à qui il gagne son pain – alors il y a de fortes chances qu’il ne respecte pas plus ses auteurs. Prenez le temps, avant de signer, d’échanger avec votre contact au sein de la maison d’édition, cela vous permettra de vous faire une idée plus juste de la politique menée dans ce domaine.
4/ Quels seront les modes de diffusion ?
Se renseigner sur les modes de diffusion et de distribution d’un éditeur est important. N’importe quel libraire peut commander n’importe quel livre du catalogue de n’importe quel éditeur. Mais tous les éditeurs ne sont pas présents sur tous les sites de vente en ligne, or ce mode d’achat est de plus en plus utilisé par les lecteurs. Il est assez facile de vérifier la présence d’un éditeur sur les plateformes de vente en tapant son nom dans la barre de recherche. Si l’éditeur n’est pas présent sur toutes les plateformes de diffusion, vérifiez s’il n’a pas son propre site de vente en ligne : c’est de plus en plus courant, notamment pour les petits éditeurs car cela leur évite de vendre à perte.
5/ Quels sont les modes de publication ?
Papier ou numérique ? Tout est affaire de goûts personnels. Je vais être publiée uniquement en format numérique, ce qui ne me pose pas de problème pour des raisons qui me sont propres. Mais chacun a ses convictions dans ce domaine..
Vous tenez à être publié en format papier ; vous êtes opposé au format numérique et tenez à ce que votre œuvre ne soit pas publiée sous ce format ; vous n’avez rien contre le numérique à condition qu’il n’y ait pas de DRM. Vous avez peut-être des exigences, alors renseignez-vous sur les modes de publications d’un éditeur avant de lui transmettre votre manuscrit.
6/ Vous sentez-vous en confiance avec cet éditeur ?
Je sais que trouver un éditeur est un véritable challenge. Vous vous êtes déjà posé pas mal de questions, vous avez fait un sacré tri, et même en ayant énormément travaillé sur votre texte et en ayant soigné le choix des maisons d’édition à qui vous alliez l’envoyer, rien ne garantit que vous trouverez preneur. Alors forcément, dans ces conditions, faire le difficile peut vous sembler capricieux. Pourtant, il est important de choisir avec soin la personne avec qui vous signerez. La publication d’un manuscrit est un travail d’équipe qui demandera beaucoup d’échanges et de compréhension. Certes, c’est l’éditeur qui vous aidera à trouver votre lectorat, mais vous êtes aussi celui qui apporte de l’eau au moulin de l’éditeur. Vous devrez être impliqué dans la phase de production éditoriale, de promotion, et ces deux étapes se feront main dans la main avec l’éditeur. C’est pourquoi il vaut mieux choisir une maison d’édition où vous vous sentirez en confiance, avec qui le contact est facile et l’échange fructueux. Si, dès le début, ça ne passe pas, alors ça risque de bloquer plus tard aussi.
Une fois que vous avez trouvé la réponse à toutes ces questions, vous devez constituer une liste d’éditeurs à qui envoyer votre manuscrit. N’oubliez pas de vous renseigner sur le mode de soumission (certains exigent une soumission sous format papier, d’autres n’acceptent que le numérique) et joignez une lettre expliquant pourquoi vous leur envoyez votre manuscrit. À ce sujet, je vous suggère le très drôle mais très vrai article de Nathalie Dau sur la lettre d’accompagnement.